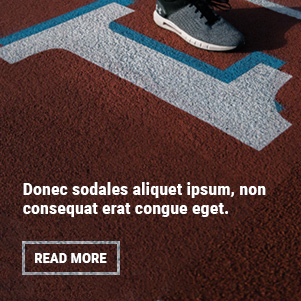Il y a plusieurs décennies, l’obtention d’un titre foncier au Tchad était une démarche simple, peu coûteuse et souvent informelle.
Cette époque, la formalisation de la propriété foncière se faisait généralement par des échanges symboliques ou cérémoniels, avec peu de formalités administratives et sans passer par un cadre juridique strict. La confiance communautaire, les traditions locales et de faibles coûts matériels facilitaient l’accès à la propriété, souvent en échange d’objets de valeur ou de gestes symboliques, sous l’œil parfois indifférent des institutions publiques.Avec l’évolution démographique, l’urbanisation et la nécessité de sécuriser davantage les droits fonciers, la législation s’est durcie. Aujourd’hui, obtenir un titre foncier nécessite de longues démarches administratives, coûteuses, et souvent dissuasives pour les populations aux ressources limitées. Cette politique renforcée a creusé le fossé social, les plus aisés peuvent rapidement sécuriser leur propriété, tandis que la majorité reste exposée à l’insécurité foncière, voire dépendante du système coutumier.Ce changement a aussi eu impacter le marché locatif, notamment à Ndjamena, où les loyers même pour des chambres en matériaux non durables atteignent désormais 20 à 30 000 CFA, alors que les revenus des Tchadiens peinent à dépasser le SMIG. Une disparité sociale de plus en plus visible, que certains responsables publics abordent souvent avec légèreté.La transition d’un système accessible à une élite restreinte illustre clairement l’accroissement des inégalités sociales dans le pays.