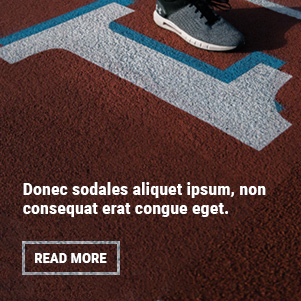Les Etats africains doivent consolider leurs états civils et accélérer la numérisation des données publiques. D’énormes enjeux sociaux et économiques en dépendent.

Le Fonds monétaire international (FMI) s’en désolait pendant la pandémie de Covid-19 : en Afrique, une partie des aides financières destinées aux ménages les plus pauvres n’ont pu être distribuées par les Etats et les bailleurs internationaux, faute de savoir comment les envoyer, et surtout à qui. Car comment identifier les ménages les plus vulnérables, sans un système centralisé d’état civil ? Comment repérer les travailleurs informels privés de revenus par les confinements, les enfants déscolarisés, les grossesses précoces ? Comment verser des paiements numériques à des populations sans téléphone portable ?
Selon les derniers rapports de la Fondation Mo Ibrahim, seulement huit pays africains sur 54 disposent d’un système efficace d’enregistrement des décès, rendant peu fiables les chiffres des morts dues au Covid-19 : l’écart serait, selon les pays, de un à huit. La pandémie est venue souligner douloureusement l’évidence : l’Afrique manque de données numériques – et même de données tout court – sur ses populations.
Qui connaît vraiment les citoyens africains ? « Qui est M. Diallo, Mme Koné ou M. N’Diaye ? fait mine de s’interroger Jean-Michel Huet, associé du cabinet BearingPoint et spécialiste des questions liées à la transformation numérique du continent. Quelles sont leurs coordonnées ? Où et quand sont-ils nés, quel âge ont-ils ? Où habitent-ils, que font-ils dans la vie, comment s’appellent leurs enfants, ont-ils un casier judiciaire ? Toutes ces informations de base constituent l’état civil des populations. Les Etats européens disposent tous d’un modèle centralisé et numérisé de gestion de ces données. Or le gros problème en Afrique, c’est que la plupart des Etats n’en ont pas, ou dans un état désastreux. » Selon la Fondation Mo Ibrahim, la moitié des enfants nés sur le continent ne sont pas enregistrés, et donc dépourvus d’existence légale. A l’horizon 2030, ce nombre pourrait dépasser 100 millions en Afrique subsaharienne.
Données brutes
Et pourtant, les informations existent. « On aurait tort de dire que l’Afrique n’a pas de données sur ses citoyens, rappelle Yaya Sylla, président-directeur général de la société ivoirienne de conseil SaH Analytics International. Elle dispose au contraire d’immenses gisements de données, mais sous leur forme brute. » Dans le cas de la Côte d’Ivoire, par exemple, les collectivités locales tiennent les registres des naissances, mariages et décès dans les mairies, mais l’immense majorité de ces fichiers n’existent que sous leur forme physique. Or, pour recenser la population d’un Etat et, partant, pouvoir délivrer les cartes d’identité, les passeports, donner un accès au système de soins, collecter les impôts et distribuer les cartes électorales, seul vaut un système centralisé et digitalisé. « Comme pour les ressources minières, résume Yaya Sylla, l’Afrique doit s’industrialiser, s’emparer de ses ressources et les valoriser. Et cela passera par la numérisation. »
Des pays comme l’Egypte, le Maroc et le Rwanda s’y sont déjà attelés avec un certain brio. En 2014, le gouvernement de Paul Kagamé a mandaté la société RwandaOnline pour numériser tous les services publics de l’Etat en créant Irembo, un service de e-gouvernement ouvrant un accès direct aux administrations publiques pour les citoyens rwandais. Le Gabon et le Cameroun ont entrepris de mettre en place un état civil numérique en 2021, la Côte d’Ivoire veut accélérer depuis le début de l’année la numérisation des services publics initiée en 2013. Le Nigeria a annoncé en début d’année un vaste projet de formation de ses fonctionnaires, pour passer au tout-numérique d’ici à 2030.
Des initiatives basées sur les données issues de la téléphonie mobile ont aussi vu le jour à l’occasion de la pandémie de Covid-19. Le gouvernement togolais a ainsi mis sur pied en avril 2020, avec l’aide de l’ONG américaine GiveDirectly, le dispositif Novissi, qui croisait l’imagerie satellitaire et les métadonnées téléphoniques, obtenues auprès des opérateurs, pour établir une carte des foyers les plus vulnérables. Plus de 17 millions d’euros ont ainsi pu être distribués à 567 000 personnes au printemps 2020.
Consommation électrique
Se pose ensuite la question du stockage de ces données. Le continent n’héberge que 80 centres de data, soit 1,3 % du total mondial, et la moitié est concentrée en Afrique du Sud. Pour s’aligner avec ce pays, le reste du continent aurait besoin de 700 installations, estimait début 2021 l’Association africaine des data centers (ADCA). Or de telles infrastructures requièrent une température basse et une forte consommation électrique – pas moins de 1 000 mégawatts seraient requis selon le rapport de l’ADCA. Les localiser sur le continent aurait un coût économique et environnemental élevé, trop élevé pour que le jeu en vaille la chandelle, estime Jean-Michel Huet. « On pourrait tout à fait stocker les données africaines en Norvège ou au Canada, signale-t-il, où la météo est plus favorable et la distribution électrique de meilleure qualité. » Ce n’est pas parce qu’un Etat fait appel à un prestataire extérieur pour la sauvegarde physique de ses données qu’il y perd en souveraineté, affirme le consultant : le « cloud » n’a pas de frontières.
Une fois les données collectées, reste malgré tout à les protéger. Et le temps presse. Faute de régulations, le continent risque bientôt de devenir un vaste terrain de jeu pour les Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) et les quatre géants du Web chinois, les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi), avertit Yaya Sylla. « 15 % des Africains bénéficient aujourd’hui d’un accès à Internet à domicile et ce faible taux de couverture numérique nous donne pour l’instant un faux sentiment de sécurité. Mais nous avons aussi la population la plus jeune au monde et très consommatrice de téléphonie et d’Internet mobile ! Les multinationales, comme d’ailleurs les organisations cybercriminelles, ont commencé à flairer la numérisation accélérée du continent, et cela aiguise leur appétit. »
En 2020, un rapport conjoint e-Conomy Africa de Google et la Société financière internationale (SFI) – la filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé – évaluait que l’économie numérique africaine vaudrait 712 milliards de dollars (680 milliards d’euros) d’ici à 2050, soit 8,5 % du PIB continental. Google multiplie d’ailleurs les initiatives pour connecter le continent à l’Internet. Après avoir tenté d’apporter la 4G au Kenya grâce à d’énormes ballons à hélium – un projet auquel il a aujourd’hui renoncé –, le géant d’Alphabet veut désormais tendre un immense câble sous-marin entre l’Europe et l’Afrique pour étendre la couverture internet et accroître le débit, au Nigeria et en Afrique du Sud notamment.
« Prise de conscience collective »
Autant de prouesses techniques et de louables ambitions qui ne doivent pas faire oublier que le modèle économique des multinationales reste fondé sur la commercialisation des données personnelles des internautes. Les gouvernants africains en ont déjà pris conscience, salue Yaya Sylla.
La Côte d’Ivoire a été la précurseure des régulations numériques, en adoptant dès 2013 une loi sur la protection des données personnelles et en lançant l’Autorité ivoirienne de protection de ces données, sur le modèle du Règlement général européen sur la protection des données (RGPD). Cette protection, affirme Yaya Sylla, doit désormais être étendue et renforcée. « Avec tout ce qu’on voit comme trafics illégaux, comme arnaques en ligne, fraudes bancaires, usurpations d’identité…, nos gouvernants ont tout intérêt à mettre en place une politique réelle de protection des données, en particulier des données à caractère personnel, dotée d’un vrai arsenal judiciaire. »
Reste à sensibiliser les usagers à ces enjeux et, sur ce plan, tout reste à faire. « Le citoyen lambda, dans son petit village, peut maintenant utiliser Facebook grâce aux offres Internet low cost. Mais il profite de cette gratuité sans s’interroger sur les données qu’il met à disposition de Meta et consorts, poursuit Yaya Sylla. Il faut provoquer une prise de conscience collective sur la protection des données, et cela passera avant tout par la formation. »
Eduquer les jeunes Africains dès l’école primaire, pour les sensibiliser à un usage prudent d’Internet. Mais aussi former les techniciens et les ingénieurs africains de demain, à qui échoira la vaste tâche de numériser, centraliser et sécuriser ces gigantesques filons de données brutes, nouvel « or noir » du continent.
Le Monde Afrique